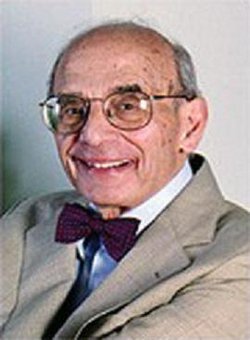
Architecte de l’apprentissage organisationnel et pionnier de l’organisation apprenante
« L’apprentissage ne consiste pas simplement à ajouter plus de connaissances à une organisation ; cela nécessite souvent de désapprendre des croyances et des routines profondément ancrées. »
Chris Argyris
Psychologue et chercheur américain, Chris ARGYRIS a marqué la théorie des organisations en révélant les mécanismes cognitifs et comportementaux qui entravent ou favorisent l’apprentissage collectif. Professeur à Harvard et Yale, il a conceptualisé des modèles clés comme l’apprentissage en double boucle et les routines défensives, jetant les bases des organisations apprenantes.
Sa collaboration avec Donald SCHÖN a permis de conceptualiser les mécanismes par lesquels les organisations apprennent, s’adaptent ou résistent au changement, ouvrant la voie aux théories modernes de l’organisation apprenante.
Ses travaux, à la croisée de la psychologie sociale et du management stratégique, offrent des outils pour décrypter les résistances au changement et transformer les pratiques managériales.
• Mots clefs et domaines :
Apprentissage en double boucle – Routines défensives – Théorie de l’action – Désapprentissage
• Contributions majeures :
1. Théorie de l’apprentissage organisationnel
ARGYRIS a conceptualisé deux niveaux d’apprentissage qui demeurent fondamentaux dans la théorie organisationnelle moderne :
• L’apprentissage en simple boucle (single-loop learning) : Processus par lequel une organisation détecte et corrige des erreurs sans remettre en question ses politiques, objectifs ou valeurs fondamentales. Il s’agit d’ajustements correctifs qui permettent de maintenir la performance dans le cadre existant.
• L’apprentissage en double boucle (double-loop learning) : Démarche plus profonde où l’organisation remet en question ses postulats, normes et cadres conceptuels sous-jacents. Ce processus, plus difficile à mettre en œuvre, permet l’innovation et l’adaptation véritable aux changements environnementaux.
ARGYRIS a mis en évidence l’écart entre la « théorie professée » (espoused theory) — ce que les individus et organisations prétendent faire — et la « théorie d’usage » (theory-in-use) — ce qu’ils font réellement. Il a identifié comment les routines défensives empêchent les organisations d’apprendre en évitant la remise en question et la confrontation constructive des problèmes.
2. Modèles d’action et routines défensives
ARGYRIS a développé des méthodologies d’intervention pour aider les organisations à surmonter leurs défenses et à faciliter l’apprentissage en double boucle. Son approche de recherche-action vise à créer des conditions favorables au dialogue authentique et à la résolution efficace des problèmes.
• Le Modèle I caractérise les comportements défensifs : contrôle unilatéral, protection de soi, rationalisation des échecs, évitement des critiques.
• Le Modèle II propose une alternative : Dialogue ouvert, tests empiriques des hypothèses, leadership collaboratif.
• Utilité et actualité :
Les apports d’Argyris sont particulièrement pertinents dans le contexte actuel de transformation permanente des organisations :
• Ils fournissent un cadre conceptuel pour comprendre les résistances au changement
• Ils permettent de diagnostiquer les blocages dans les processus d’innovation
• Ils inspirent les démarches d’amélioration continue (Lean, Kaizen, agilité, …)
• Ils constituent un socle théorique pour les pratiques de knowledge management
• Limites:
Malgré leur richesse conceptuelle, les travaux d’ARGYRIS présentent certaines limites :
• La mise en œuvre de l’apprentissage en double boucle reste complexe et se heurte souvent aux structures de pouvoir
• Ses méthodes d’intervention requièrent des compétences approfondies et un engagement substantiel de la part des managers
• La dimension culturelle et contextuelle de l’apprentissage organisationnel est parfois sous-estimée
En introduisant plus de flexibilité et de dynamisme dans la compréhension des besoins humains, Alderfer a contribué à façonner les approches modernes de la motivation au travail. Son apport le plus durable est peut-être d’avoir souligné que la motivation est multifactorielle et adaptable : les managers doivent simultanément veiller aux conditions d’existence (salaire, sécurité), aux relations (climat d’équipe, reconnaissance sociale) et aux opportunités de développement, sans supposer qu’un seul facteur domine toujours les autres. La théorie ERG, combinée à d’autres approches, a contribué à élaborer des politiques RH plus complètes (rémunération, team-building, plans de carrière, …). Si elle n’est pas un modèle prédictif absolu, elle reste un rappel utile de la diversité des moteurs de motivation et de la nécessité d’une approche individualisée , une approche largement intégrée dans le management actuel.
• Bibliographie principale
• Alderfer, C. P. (1969). « An Empirical Test of a New Theory of Human Needs ». Organizational Behavior and Human Performance, 4(2), 142-175.
• Alderfer, C. P. (1972). Existence, Relatedness, and Growth: Human Needs in Organizational Settings. Free Press.
• Alderfer, C. P. (1989). « Theories Reflecting My Personal Experience and Life Development ». Journal of Applied Behavioral Science, 25(4), 351-365.
• Schneider, B., & Alderfer, C. P. (1973). « Three Studies of Measures of Need Satisfaction in Organizations ». Administrative Science Quarterly, 18(4), 489-505.
• Wanous, J. P., & Zwany, A. (1977). « A Cross-Sectional Test of Need Hierarchy Theory ». Organizational Behavior and Human Performance, 18(1), 78-97.

Copyright © 2025 All rights reserved





